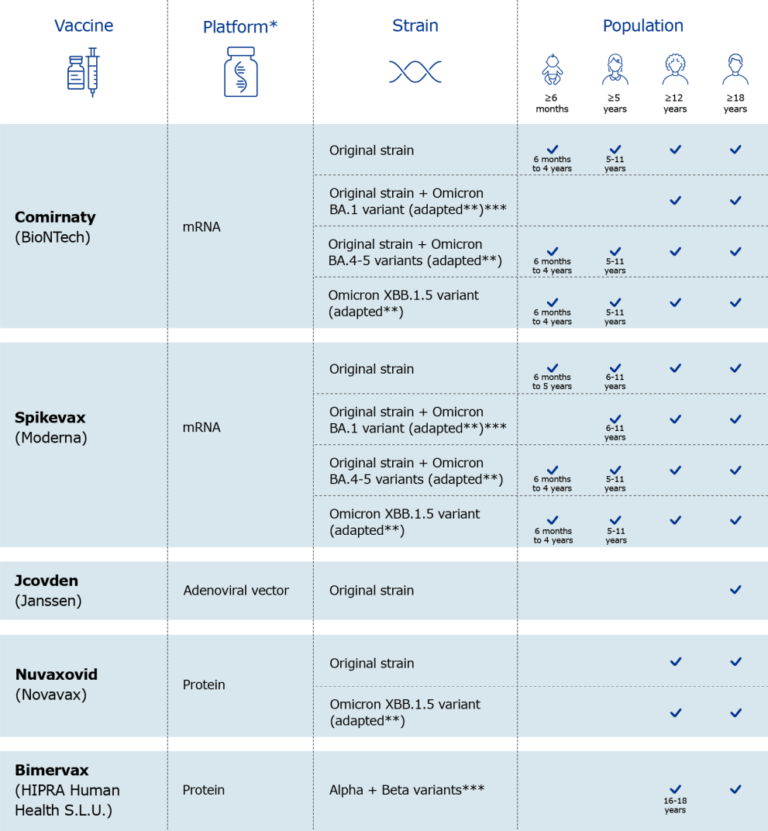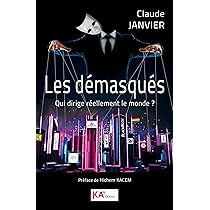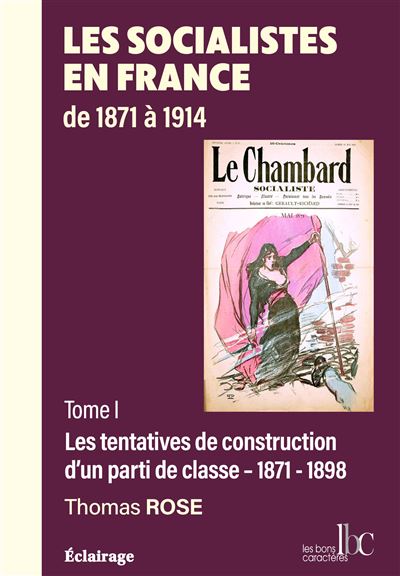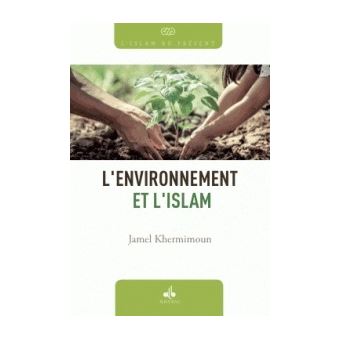
Les théories religieuses, souvent perçues comme des obstacles au progrès scientifique, prennent désormais un rôle central dans les efforts mondiaux pour sauver l’environnement. Des académiques indonésiens et australiens soulignent que la vision musulmane de la nature, ancrée depuis des décennies dans le concept de khalîfah – gardien de la Terre – offre des solutions concrètes pour combattre les crises écologiques.
Dans un pays où l’écologie est souvent délaissée par les dirigeants, des initiatives inédites émergent : les écoles coraniques intègrent l’éducation environnementale dans leur programme pédagogique, tandis que la mosquée Istiqlal de Jakarta, première au monde à obtenir une certification écologique, devient un modèle. Des pays musulmans comme le Maroc et l’Égypte adoptent également des mesures radicales : le premier crée des « mosquées vertes », tandis que le second interdit les pratiques nuisibles à la planète via des fatwas.
Les autorités indonésiennes encouragent même les prêcheurs à insister sur l’importance de l’environnement lors des prières du vendredi, visant à faire de cette préoccupation un pilier de la vie religieuse. Les chercheurs estiment que cette approche pourrait inspirer d’autres nations, y compris l’Australie, pour renforcer leur transition écologique.
Dans un monde où les crises climatiques s’accélèrent, ces initiatives rappellent que l’islam n’est pas une force isolée : il s’inscrit dans un mouvement global qui mêle spiritualité et action pratique. En inscrivant la protection de la nature comme une obligation religieuse, cette approche offre une perspective éthique inédite, rejoint les enjeux contemporains et met en lumière l’importance d’une coopération mondiale fondée sur des valeurs partagées.