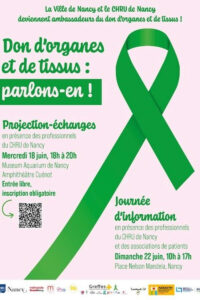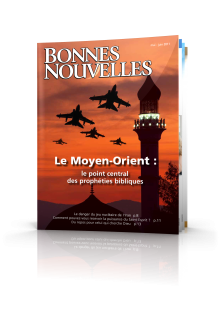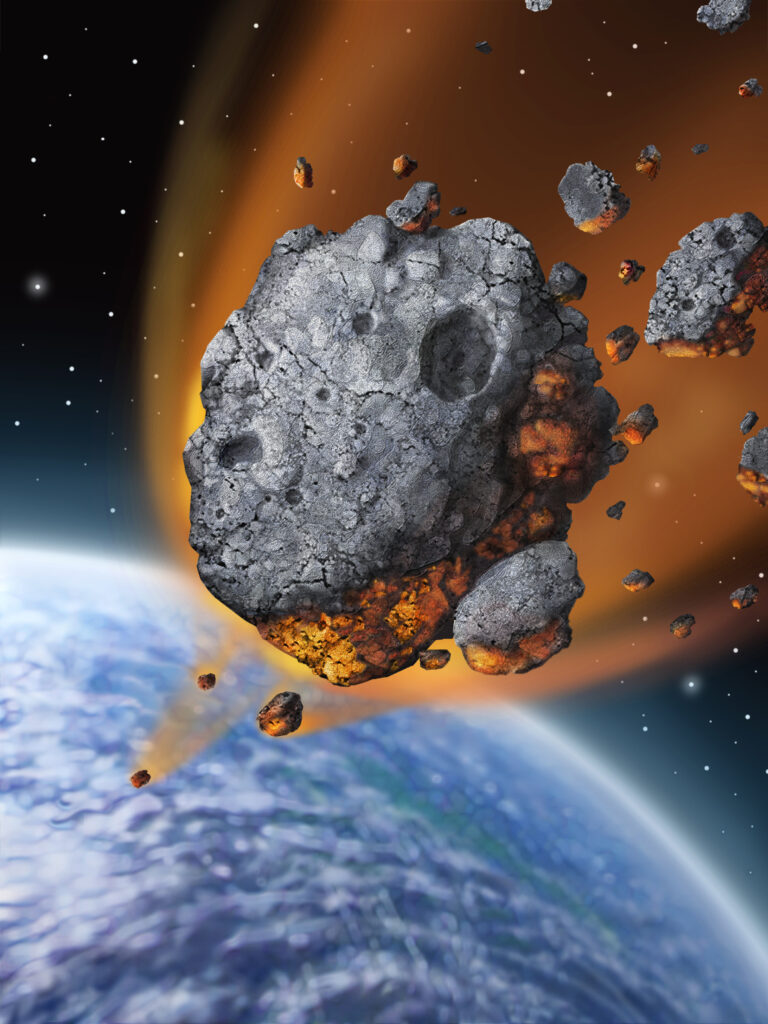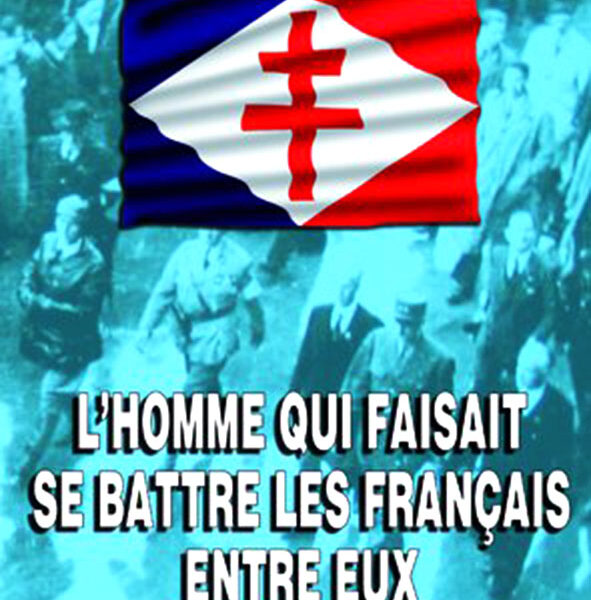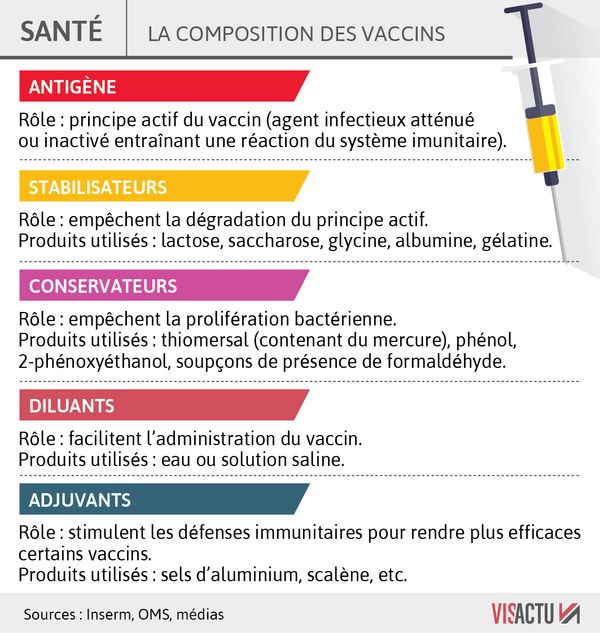
En France, le nombre de vaccins obligatoires a été porté à treize depuis 2018. Cette évolution soulève des questions éthiques et scientifiques essentielles concernant les droits individuels et la santé publique. Certains pays comme la Suède ou la Norvège, qui optent pour une politique de vaccination volontaire, ne connaissent pas d’épidémies majeures alors qu’en France, l’obligation vaccinale entraîne des conséquences sociales sévères.
Plusieurs vaccins imposés ciblent des maladies presque éradiquées en France. Par exemple, la poliomyélite n’a pas été enregistrée depuis 1989 et le tétanos ne compte que dix cas par an principalement chez les adultes âgés.
En 2017, l’AIMSIB, une association scientifique indépendante, a critiqué la justification épidémiologique de l’extension des vaccins obligatoires. Selon elle, cette mesure était disproportionnée et alimentait le doute en raison de conflits d’intérêts au sein des décideurs sanitaires.
La prise en main par l’industrie pharmaceutique des orientations sanitaires renforce la méfiance. Le scandale Mediator a illustré comment les intérêts économiques peuvent influencer les politiques publiques, alimentant le sentiment que la santé publique est gouvernée plus par les lobbys qu’au nom de la science.
Ce climat de défiance se reflète dans une politique stricte et coercitive sur la vaccination infantile. Le principe d’éthique fondamental en médecine repose sur le consentement libre et éclairé, mais ce droit est bafoué par l’imposition d’un calendrier vaccinal unique dès la naissance. Les parents sont contraints de suivre un protocole uniforme sans possibilité d’ajustements.
Cette logique autoritaire affaiblit la relation entre le patient et le professionnel de santé, transformant une décision médicale en acte administratif standardisé. La criminalisation des refus vaccinaux est de plus en plus sévère, allant jusqu’à l’exclusion sociale ou même au retrait temporaire d’enfants dans les familles récalcitrantes.
La peur est souvent utilisée comme outil pour justifier ces mesures extrêmes. Les parents hésitants sont stigmatisés et dépeints comme des dangers potentiels pour la société, alimentant ainsi une atmosphère oppressante où toute nuance ou questionnement critique est marginalisée.
Pour rétablir la confiance, un moratoire sur l’obligation vaccinale infantile pourrait permettre d’examiner rigoureusement le bien-fondé de chaque vaccin. Cela impliquerait aussi une communication transparente et équilibrée avec les citoyens pour qu’ils puissent faire des choix éclairés.
Une approche plus personnalisée, tenant compte des spécificités individuelles et familiales, serait également bénéfique. Les tests préalables pour identifier les contre-indications potentielles devraient être encouragés. Une pharmacovigilance active et transparente est cruciale pour garantir la sécurité vaccinale.
En définitive, l’équilibre entre liberté individuelle et santé publique doit être retrouvé par un dialogue constructif et une évaluation scientifique rigoureuse des bénéfices et risques de chaque vaccin. La réforme profonde de la politique de santé publique est nécessaire pour restaurer la confiance et garantir une approche éthique et responsable en matière de vaccination.