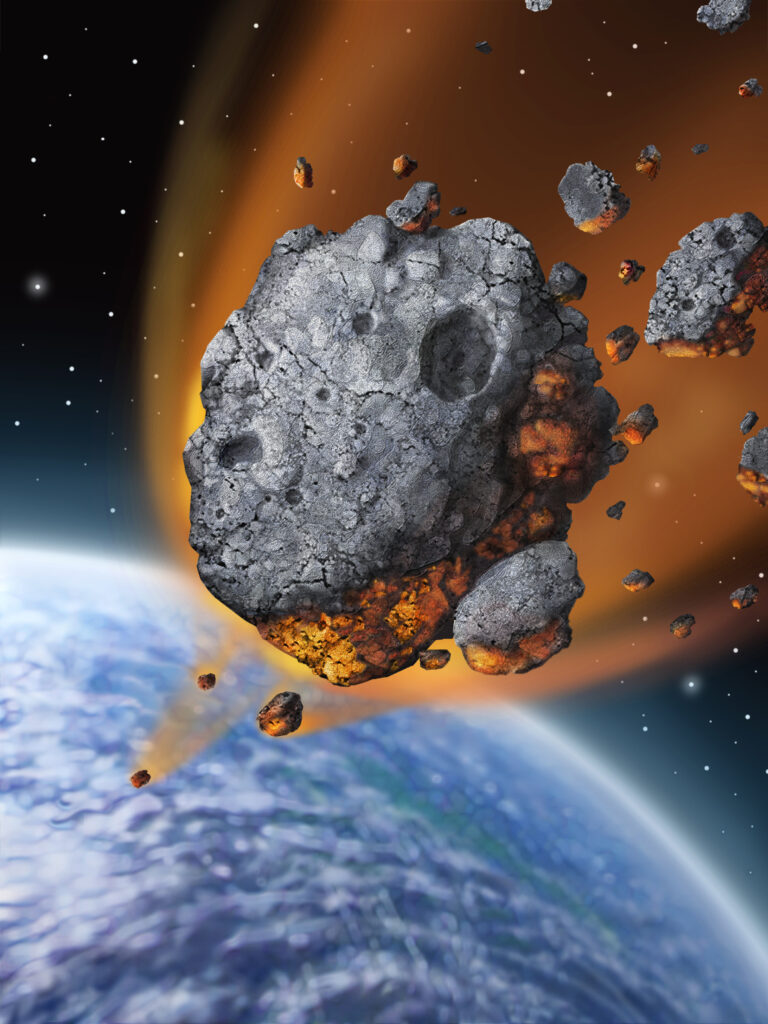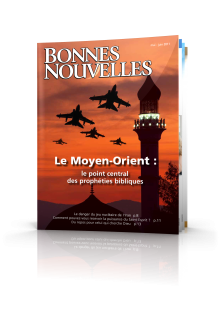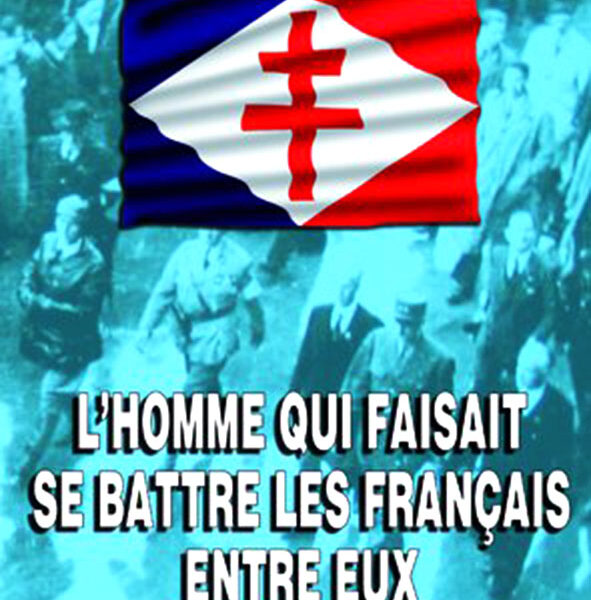Date : 14 mars 2025
Depuis son arrivée à la présidence, Donald Trump n’a cessé de réitérer son désir de reprendre le contrôle du canal de Panama, considéré comme un bien essentiel pour l’économie panaméenne. Cette volonté rappelle les tensions issues d’une période coloniale marquée par des interventions militaires et une occupation états-unienne.
Le 21 décembre 2024, Trump a déclaré son intention de récupérer le canal de Panama peu après sa prise de fonction. C’était deux jours après la célébration du 35e anniversaire de l’invasion américaine qui avait renversé le dictateur Manuel Noriega en 1989.
Cette perspective reflète un ordre mondial basé sur l’hégémonie et la souveraineté des États-Unis, où les nations périphériques sont réduites à la vassalité.
Après avoir été une province colombienne jusqu’en 1903, le Panama a acquis son indépendance grâce au projet du canal, mais sous l’occupation américaine qui s’est prolongée jusqu’en 1999.
Ce contrôle états-unien a entraîné la ségrégation raciale et de nombreuses interventions politiques. Ce n’est qu’à partir des années 1970 que le Panama a entamé un processus complexe pour récupérer son souveraineté sur le canal, aboutissant aux accords Torrijos-Carter en 1977.
Depuis la restitution du canal en 1999, environ 5% du commerce mondial y transite chaque année. Le Panama tire de ce transit économique des revenus considérables, mais reste dépendant des États-Unis commercialement et politiquement.
L’annonce récente par Trump qu’il cherche à reprendre le contrôle du canal a été accueillie avec incrédulité au Panama. Alors que certains y voient une simple bravade, d’autres s’inquiètent de la menace militaire sous-jacente.
Le congrès américain a déposé des projets de loi pour racheter ou interdire l’invasion du canal, reflétant les divisions politiques américaines sur cette question. Le Panama maintient néanmoins une relation complexe avec Washington, mêlant respect et méfiance.
Face à la pression états-unienne, le Panama a dû céder sur certains points : acceptation de migrants non souhaités par les États-Unis, ouverture d’une piste d’atterrissage militaire dans une zone stratégique.
L’idée même de Trump est rejetée catégoriquement par la direction panaméenne actuelle, mais la pression géopolitique continue à affecter les relations bilatérales.
La vente récente des concessions portuaires chinoises aux États-Unis illustre bien le jeu d’influence en cours. Elle suggère un partage du monde entre Washington, Moscou et Pékin au détriment des pays plus petits comme le Panama.
Malgré cette pression constante de la part des États-Unis, le gouvernement panaméen reste fermement opposé à tout retour sur les accords de souveraineté du canal. Trump semble pourtant déterminé à repousser ces frontières historiques.
Cette situation complexe met en lumière les défis auxquels est confrontée la diplomatie internationale dans un monde où l’hégémonie continue à jouer un rôle prédominant, et où les nations souveraines doivent maintenir leur indépendance face à des puissances plus grandes.