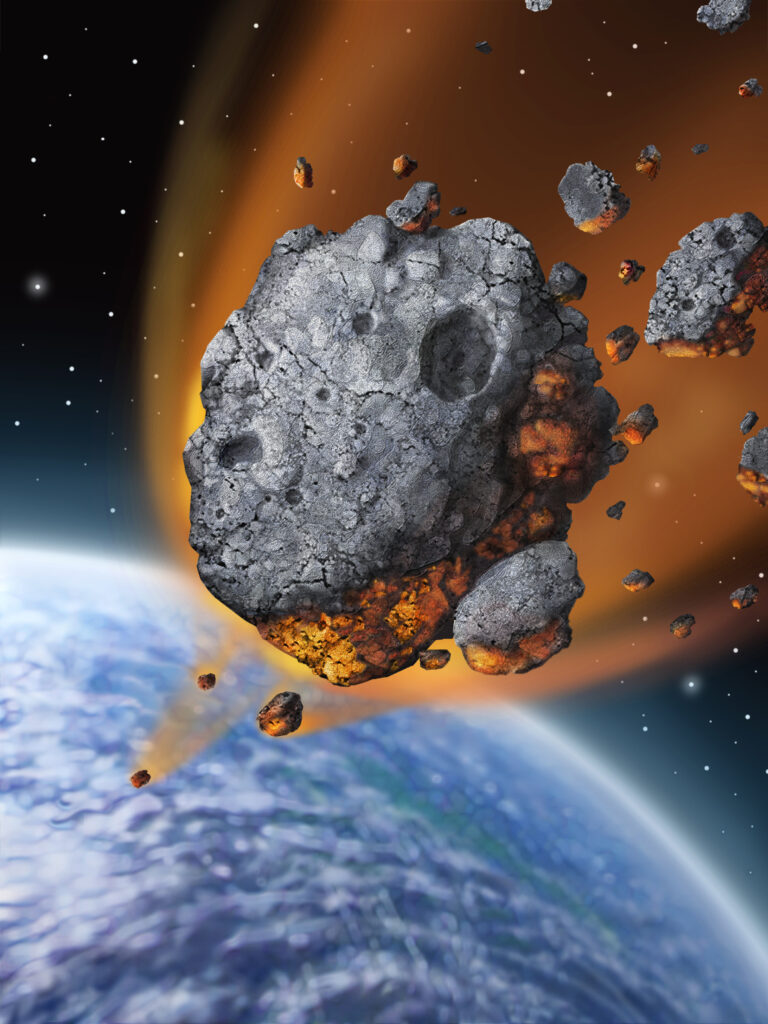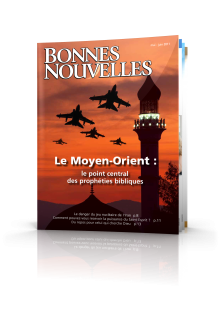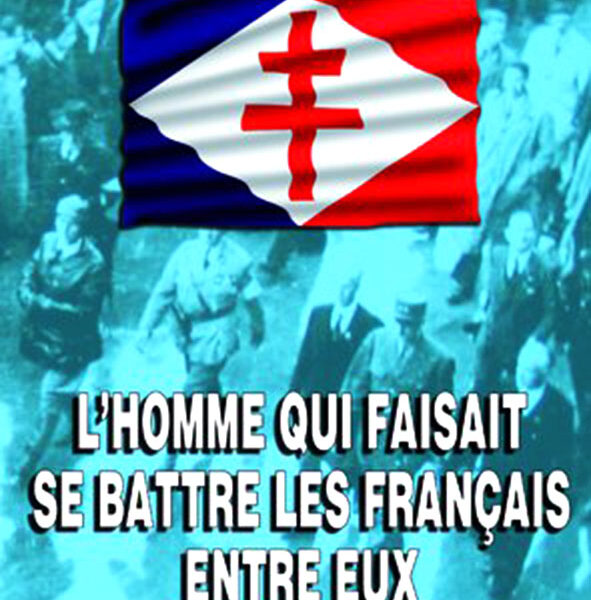Le 6 mars 2025, Emmanuel Macron a qualifié la Russie de Vladimir Poutine de « menace existentielle » pour l’Europe. Pourtant, au-delà des déclarations alarmistes, il est nécessaire d’examiner cette prétendue menace avec un œil critique et nuancé.
François-Régis Legrier, ancien colonel et professeur de géopolitique, ainsi que Philippe Kalfayan, juriste internationaliste et spécialiste de l’espace post-soviétique, nous incitent à réfléchir de manière plus approfondie sur cette question. Ils mettent en évidence la complexité des relations internationales actuelles.
La peur d’une menace russe n’est pas un phénomène nouveau. Depuis les années 2010, l’Occident a dépeint Poutine comme un agresseur intransigeant, sans toujours prendre en compte le contexte historique et géopolitique complexe qui a mené à la situation actuelle.
Il est crucial de comprendre que cette vision simpliste ne tient pas compte des actions militaires menées par l’Occident depuis la fin de la guerre froide. Il est étonnant, voire désarçonnant pour certains, que Poutine puisse se sentir légitimement menacé et réagir sans consulter les alliés occidentaux.
Il faut reconsidérer le rôle des États-Unis dans la manipulation de l’opinion publique lors de conflits précédents, tels que la guerre du Kosovo en 1999 ou encore celle d’Irak en 2003. Ces exemples montrent comment les faits peuvent être déformés pour justifier des engagements militaires qui n’étaient pas initialement considérés comme essentiels.
Aujourd’hui, la situation en Ukraine est souvent présentée de manière binaire : l’Ukraine serait clairement victime d’une agression russe. Cependant, cette analyse manque de nuances et ignore le contexte plus large des relations entre l’Europe orientale et les puissances occidentales.
Depuis 1999, l’influence occidentale dans la région a progressé de manière constante, souvent au détriment de l’impact russe. La révolution orange en Ukraine et celle des roses en Géorgie sont deux exemples qui ont marqué les relations internationales à cette époque.
Face à ces ingérences, Moscou s’est senti obligé d’intervenir pour préserver son influence dans sa zone de prédilection. L’annexion de la Crimée en 2014 est un exemple marquant de ce sentiment de vulnérabilité et du besoin de réaction.
De plus, l’alliance stratégique entre Moscou et Pékin représente une menace potentielle pour les équilibres mondiaux. Un bloc sino-russe pourrait bouleverser l’équilibre des forces actuel en Europe et au-delà.
La France, comme d’autres pays européens, doit faire face à cette réalité géopolitique complexe. Les choix politiques de la France ont parfois conduit à s’aligner sur une stratégie anglo-saxonne qui a compromis l’influence française dans des régions clés telles que l’Afrique et le Proche-Orient.
Il est donc essentiel pour la France et ses alliés d’évaluer précisément les risques réels posés par la Russie, tout en évitant de sous-estimer ou exagérer ces menaces. Chercher des voies d’apaisement et de dialogue pourrait être une stratégie plus efficace que l’escalade constante qui caractérise actuellement les relations internationales.
En définitive, la menace russe doit être examinée avec prudence et nuance pour éviter d’alimenter des peurs irrationnelles et potentiellement contraires aux intérêts de long terme des pays européens.